Une thèse originale sur l´espace-temps.
VOYAGE AU CŒUR DE LA MATRICE UNIVERSELLE
» Ceux qui ont le courage d’explorer la trame et la structure du cosmos, même si elles diffèrent profondément de leurs souhaits et de leurs préjugés, pénétreront ses plus grands mystères. «
Carl Sagan (1934-1996)

INTRODUCTION
Publié le 28 octobre 2021
Avant toute chose, je tiens à préciser que cette thèse ne
s’inscrit pas dans un travail universitaire, comme beaucoup en font
automatiquement l’association. Si l’on suit la définition du mot « thèse »
donnée par le dictionnaire Larousse : « proposition théorique,
opinion, position sur quelque chose dont on s'attache à démontrer la véracité
», mon travail peut tout à fait recevoir ce titre sans recevoir la
reconnaissance du système ou d’une quelconque ‘‘autorité’’. C’est donc avec une
liberté de pensée sans limite, sans concession et, surtout, sans avoir à rendre
de compte à qui que ce soit, que nous pourrons étudier, sous n’importe quels
angles, toutes les matières chères à notre enthousiasme de polymathe. Grâce à
cet état d’esprit, des idées originales ont pu
fleurir, s’épanouir et se révéler en dehors de la plantation dans laquelle
notre curiosité est enfermée habituellement. Être vivifié d’une telle ouverture
est une bénédiction et j’aimerais, sans avoir à rougir, partager avec vous la
rose de sa quintessence.
•••••
La genèse de cette thèse remonte au jour où mes yeux se
sont tournés vers le ciel, ou, du moins, à la nuit pendant laquelle je pris
conscience que la voûte étoilée tournait inexorablement autour d’un point fixe,
comme une roue autour d’un essieu. En contemplant ce spectacle grandiose,
jamais je n’aurais cru que mes candides réflexions sur les rouages du cosmos me
pousseraient à étudier une pléiade de disciplines, reliant l’astronomie aux
sphères – apparemment immobiles – de la minéralogie.
Je me suis tourné de prime abord vers la science
académique, et malgré des découvertes probantes dans certains domaines comme
celui de la physique quantique, j’y ai trouvé beaucoup de théories et très peu
de théorèmes. Contrairement à un théorème, une théorie se base sur des
spéculations : c’est un système formé d’hypothèses qui tente de trouver
une cohésion à des principes établis, d’ordre philosophique ou mathématique. En
d’autres termes, une théorie ne définit pas des règles et des lois immuables
dans le réel. Le dogme scientifique contemporain s’appuie en effet sur des
théories complexes qui ne se démontrent pas en dehors d’un langage mathématique
où les équations sont légion. Et comme ces dernières tendent à s’alimenter, à
s’intriquer et à se refléter mutuellement en cercle fermé, cette architecture
linguistique est propice aux abstractions les plus folles. Les lignes
d’équations sont certes très impressionnantes pour le commun des mortels, mais,
comme le soulignait René Guénon, elles s’éloignent de la réalité sensible
qu’elles prétendent expliquer.
Au fur et à mesure du ‘‘progrès’’, ces équations forment,
par la force des choses, un corps artificiel sur lequel les scientifiques
continuent de bâtir leurs travaux sans jamais remettre en cause la solidité
effective de leurs fondations. La science théorique se compare alors à une tour
de Pise, dont le corps se maintient admirablement bien, mais qui menace
de s’écrouler sous le poids de la somme de ses aberrations à chaque nouvelle avancée.
Et aussi surprenant que cela puisse paraître, cet explicite constat échappe
pourtant aux acteurs de la communauté scientifique. Actuellement, l’exemple le
plus révélateur pour confronter la complexité synthétique des mathématiques
face à la rationalité de l’environnement biologique est sans aucun doute la
théorie des cordes. Face à ses non-sens, une question se pose alors :
pourquoi continue-t-on à dépenser autant de temps, d’énergie et d’argent
à l’étude d’espaces qui n’ont aucune réciprocité avec la métrologie de la
vie terrestre ?
Avant de s’intéresser à des domaines invisibles à l’œil
nu, dans l’infiniment grand avec l’astrophysique comme dans l’infiniment petit
avec la physique des particules, peut-être que le gratin scientifique gagnerait
en authenticité s’il s’attardait davantage à réfléchir aux manifestations des
lois de la nature avec le sérieux qu’on leur doit. C’est quand même paradoxal
qu’à l’aube du XXIème siècle, la physionomie de la vie reste
toujours une énigme, des plus tenaces, au sein d’une communauté qui se vante de
connaître les prémices de notre cosmos et d’en repousser sans cesse les limites.
Peut-être devrait-elle redescendre d’un ton et s’occuper davantage de
l’essentiel : les causes (la cause ?) de la vie mériteraient beaucoup
plus d’attention que ses effets. En voulant nous impressionner avec des
abstractions conceptuelles qui ne reposent, dans l’absolu, sur rien de concret,
les prestidigitateurs des universités masquent leur incompétence et leurs
lacunes sur le(s) principe(s) élémentaire(s) de la réalité observable en
subjuguant leur auditoire – leurs élèves et les amateurs de
science-fiction – avec une poudre aux yeux assurément fascinante.
Le jour où les universitaires prendront leur distance
avec une science théorique qui ne mène nulle part, peut-être que les grandes
énigmes de la nature seront enfin reconsidérées dans leurs amphithéâtres. Quand
ce jour arrivera, la science sera de nouveau en symbiose avec les fondamentaux
de la physique universelle. Nous pourrions commencer, par exemple, à nous
intéresser à l’influence du rayonnement lunaire sur la croissance
perpendiculaire d’un végétal, ou encore la relation polarisée et analogique
entre les bronches d’un poumon et les branches d’un arbre : le premier est
à l’abri de la lumière solaire, il inspire de l’oxygène et expire du dioxyde de
carbone, le second absorbe du dioxyde de carbone et rejette de l’oxygène sous
l’influence directe du Soleil.
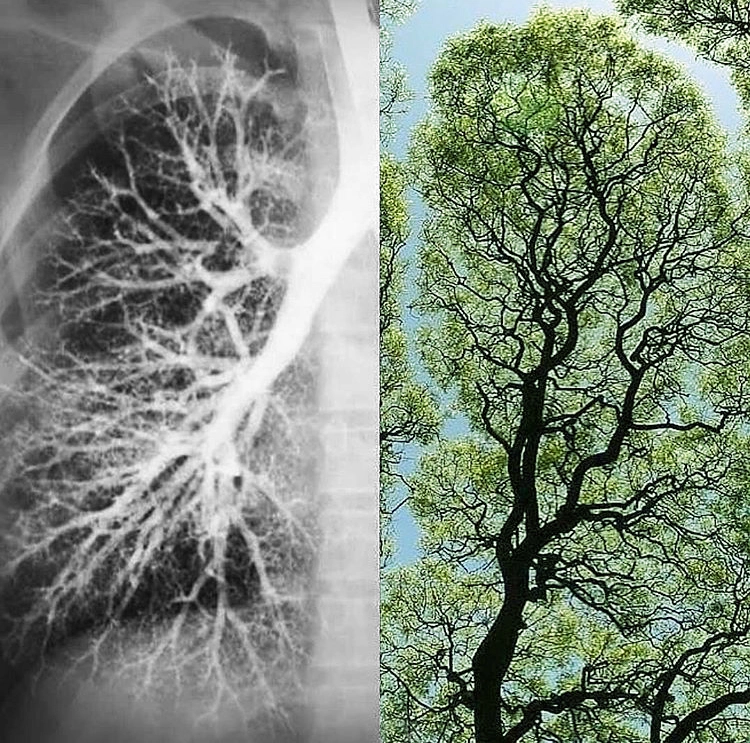
Au
début du XXème siècle, Nikola Tesla (1856-1943) – le visionnaire de la physique invisible – nous avait
déjà averti des dérives mystificatrices qu'il percevait dans la science
théorique (incarnée à son époque par Albert Einstein) dans le journal américain
The New York Times en 1931 : « Le
travail de relativité d'Einstein est un magnifique déguisement mathématique qui
fascine, éblouit et rend les gens aveugles aux erreurs sous-jacentes. La
théorie est comme un mendiant vêtu de violet que les ignorants prennent pour un
roi... Ses représentants sont des hommes brillants, mais ce sont des
métaphysiciens plutôt que des scientifiques. » En effet, le cas d’Albert Einstein est plus que
symptomatique pour révéler le marasme intellectuel dans lequel nous
baignons. En ‘‘empruntant’’ les grandes lignes de sa théorie sur la relativité
générale au physicien français Henri Poincaré (1854-1912), nous prenons très peu de risque en affirmant que la
renommée de l’icône
transgénérationnelle de la science relève plus de l’ingénierie sociale
que du génie authentique. Avoir un spoliateur comme référence adulée est un
signe des temps on ne peut plus révélateur du niveau de respectabilité que
méritent ces institutions.
Les mensonges
ne se limitent pas à l’honnêteté et à la moralité des piliers de notre société,
ils touchent aussi la technologie que nous employons au quotidien. À l’heure où
les ondes électromagnétiques connectent tous les habitants de la Terre,
l’anachronisme entre l’ingénierie d’un téléphone portable et celle du moteur à
explosion, dont la technologie de base est vieille d’environ cent-soixante-dix
ans, est plus que risible. Cela soulève une question à méditer en toute
sincérité : les travaux ‘‘scientifiques’’ portés au firmament par le système,
sont-ils les seuls qui ne menacent pas son hégémonie et la prospérité de son
modèle économique ? La question mérite au moins d’être creusée…
Prenez
donc garde : si vous voulez obtenir le diplôme d’une université
prestigieuse et faire carrière, il est préférable d’éviter certains sujets.
Diriger vos recherches en dehors du cadre imposé par le conformisme régalien,
surtout lorsqu’elles s’attaquent aux théories des dieux indétrônables du
panthéon scientifique, est une erreur à ne pas commettre. Malgré les impasses
manifestes, il est aujourd’hui impensable de remettre en cause les croyances
structurelles de l’Église scientifique. Refuser de se prosterner devant ses
idoles signerait votre excommunication, la perte de votre crédibilité et de
votre respectabilité.
Comme
je n’ai rien à perdre, à gagner, ou même à prouver, il m’est plus facile de
mettre en lumière la frivolité de la physique ‘‘extraterrestre’’ en ce qui
concerne le premier intérêt de cette étude : les révolutions des astres
au-dessus de nos têtes. Bien que les astrophysiciens soient toujours à des
années-lumière de mettre en évidence la mécanique sous-jacente à ces
révolutions, ils s’obstinent toujours, ancrés dans le dogme de leur éducation,
à vouloir démontrer ce phénomène par la loi universelle de la gravitation d’Isaac
Newton (1642-1726). L’équation de cette théorie permet certes de quantifier
les paramètres de la chute d’un objet sur Terre, et donne une solution
mathématique pour expliquer l’équilibre entre deux corps célestes, mais ne
précise absolument pas la cause de leur déplacement, régulier qui plus est.
Depuis que l’ancien président de la Royal Society s’est prononcé sur la
loi de la gravité, aucun membre de l’establishment ne cherche à s’étendre, avec
un sérieux appliqué et digne de la méthode scientifique, sur la cause de la
force de rotation (vectorisée par f dans l’illustration ci-dessous, où la course orbitale de
la Lune autour du centre de la Terre est prise comme exemple). Cette force,
pour reprendre la nomenclature courante, n’est jamais prise en compte :
c’est précisément là que le bât blesse.
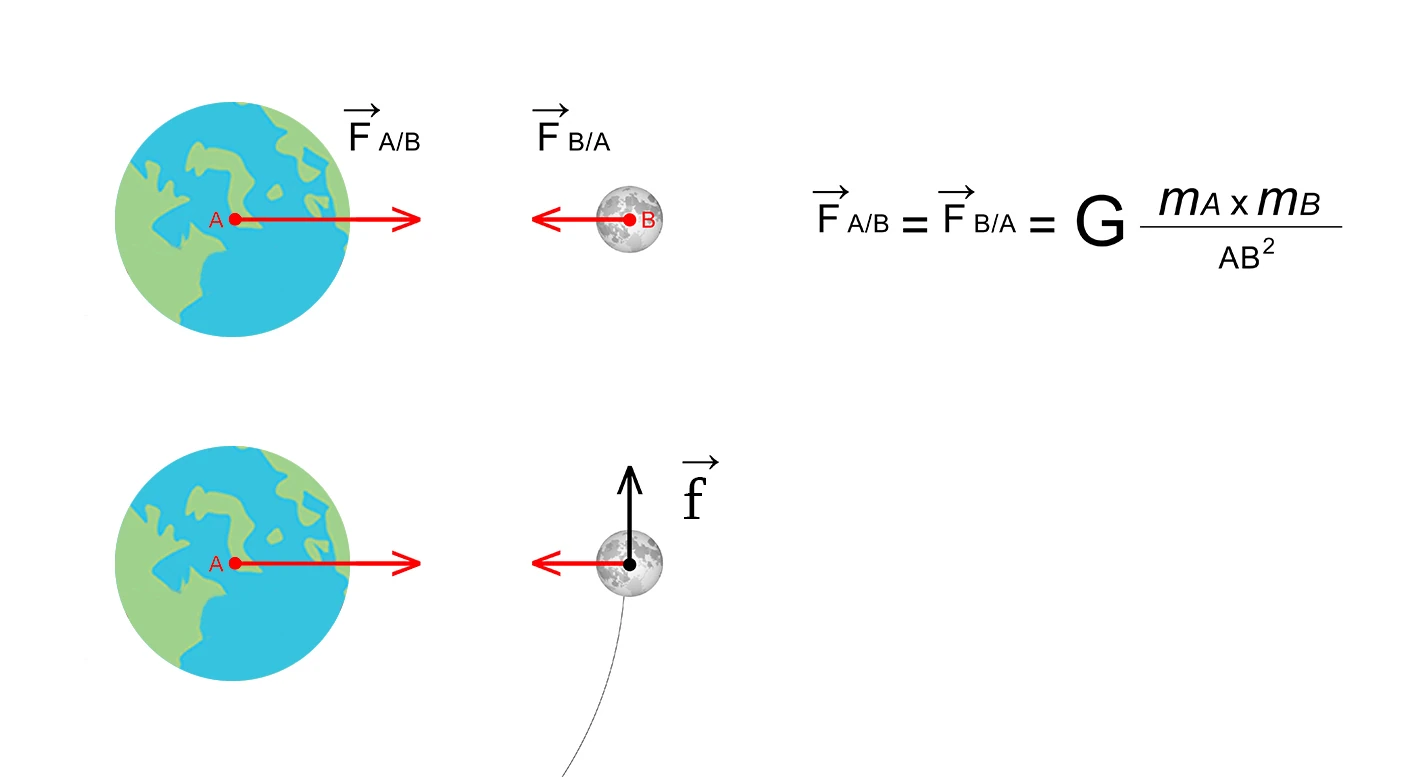
Si
aucun élément de réponse sur l’origine de la force f ne peut être formulé, la gravité ne peut pas être
validée telle qu’elle est présentée par la cosmologie contemporaine. En plus de
cela, n’oublions surtout pas qu’aucun appareil ne peut la détecter et qu’aucun
scientifique ne peut reproduire son champ en laboratoire. De toutes les
interactions fondamentales, et parce qu’elle échappe le plus à notre
compréhension, cette soi-disant force de cohésion reste l’un des plus épais
mystères de la physique d’aujourd’hui. En conséquence, il ne faut pas avoir
peur de reconnaître que le manque de rigueur scientifique qui entoure ce
concept n’est pas rassurant sur la qualité de l’expertise et affaiblit les
piliers sur lesquels sa réputation repose. Malgré tout, des spéculations,
toujours plus invraisemblables les unes que les autres, continuent de se faire
valoir sur la scène scientifique. Mais en vérité, depuis la théorie de la
courbure de l’espace-temps et les hypothétiques particules subatomiques du
monde quantique appelées gravitons,
nous n’avons pas avancé d’un iota. Pourquoi ? Simplement parce que l’origine de
ce phénomène naturel reste toujours insondable avec la science de nos pairs. Les
physiciens se contentent toujours d’expliquer que la cinétique des corps
célestes est la réminiscence d’une hypothétique explosion à l’origine de notre
univers – le fumeux ‘‘big-bang’’ – présenté au monde par le jésuite Georges
Lemaître du début du XXème siècle.
La
gravité newtonienne pose un autre problème : l’unification entre la mécanique
quantique et la théorie de la relativité générale. Si la gravité ne peut pas
être retirée de l’équation, il faut savoir reconnaître que la physique
théorique se heurte, une fois de plus, aux frontières de ses propres
extravagances.
Une
fois que nous avons accepté le fait que certaines théories sont actuellement
enseignées comme des vérités, il est plus simple d’admettre que la science a
perdu le cœur de sa beauté intrinsèque. Les heures glorieuses qui firent sa
réputation sont désormais derrière elle et les flambeaux qui la dissociaient de
la religion diffusent dorénavant une lumière plus que faiblarde. Richard
Feynman (1918-1988), prix Nobel de Physique
en 1965 pour ses travaux sur le développement de l'électrodynamique quantique,
n’avait aucun problème à avouer que : «
la science est la croyance en l'ignorance des experts ».
Même
si le modèle standard de l’astrophysique semble se satisfaire, notre
appréhension de l’univers reste toujours juvénile, incorrecte et cousue de fils
blancs. Le genre humain ne pourra jamais s’émanciper de son âge de pierre
cosmique si nous nous acharnons à vouloir construire, toujours plus haut, sur
les fondations d’une “science” qui a démontré ses limites et qui relève plus de
la théorie fantastique que du théorème empirique. C’est un fait : la
science a sombré dans des systèmes doctrinaux dont elle a du mal à faire
l’exorcisme. Et les garde-fous universitaires, auréolés d’une vanité affichée,
ne manquent jamais l’occasion de ridiculiser tout ce qui n’est pas issu de leur
champ des possibles. Une telle mentalité ne pourra jamais initier le changement
de paradigme dont le monde scientifique a besoin pour évoluer. Le jour où notre
approche fusionnera avec les principes à la source de la création, peut-être
que la nature nous révélera de nouveau les engrenages utilisés par le régisseur
de sa magistrale horloge.
•••••
En dépit de ce consensus, aussi agaçant soit-il, il
ne faudrait surtout pas tomber sous les projecteurs de l’extrémisme et rejeter
toutes les théories d’un revers de main ; parce qu’elles émanent, non plus
des mathématiques, mais de l’intelligence pure, certaines sont dignes d’intérêt.
Nous pensons particulièrement aux notions quelque peu obscures d’énergie et de
matière noire, qui ont mis en ébullition la communauté scientifique suite aux
observations d’Edwin Hubble en 1929. Depuis, beaucoup d’astrophysiciens pensent
que l’expansion de notre univers serait liée à un phénomène dynamique,
invisible et intrinsèque à l’espace.
Considéré vide à 96% (6), cet espace ne le
serait pas du tout ; il serait rempli d’une essence énergétique,
indescriptible à notre monde tangible, qui interagirait néanmoins avec lui. Le
vide serait donc plein d’une essence cinétique, plus ou moins dense, que
personne ne peut, pour l’instant, expliquer, mesurer ou reproduire. Il n’est
donc pas impossible que derrière le monde accessible aux sens de l’homme se
cache un continuum dont nous ignorons totalement l’existence. Et ce n’est pas
David Bohm (1917-1992), un des pères de la
physique quantique, qui nous apportera la contradiction puisqu’il déclara : « L’espace n’est pas vide, il est plein.
L’univers n’est pas séparé de cette mer cosmique d’énergie noire. »
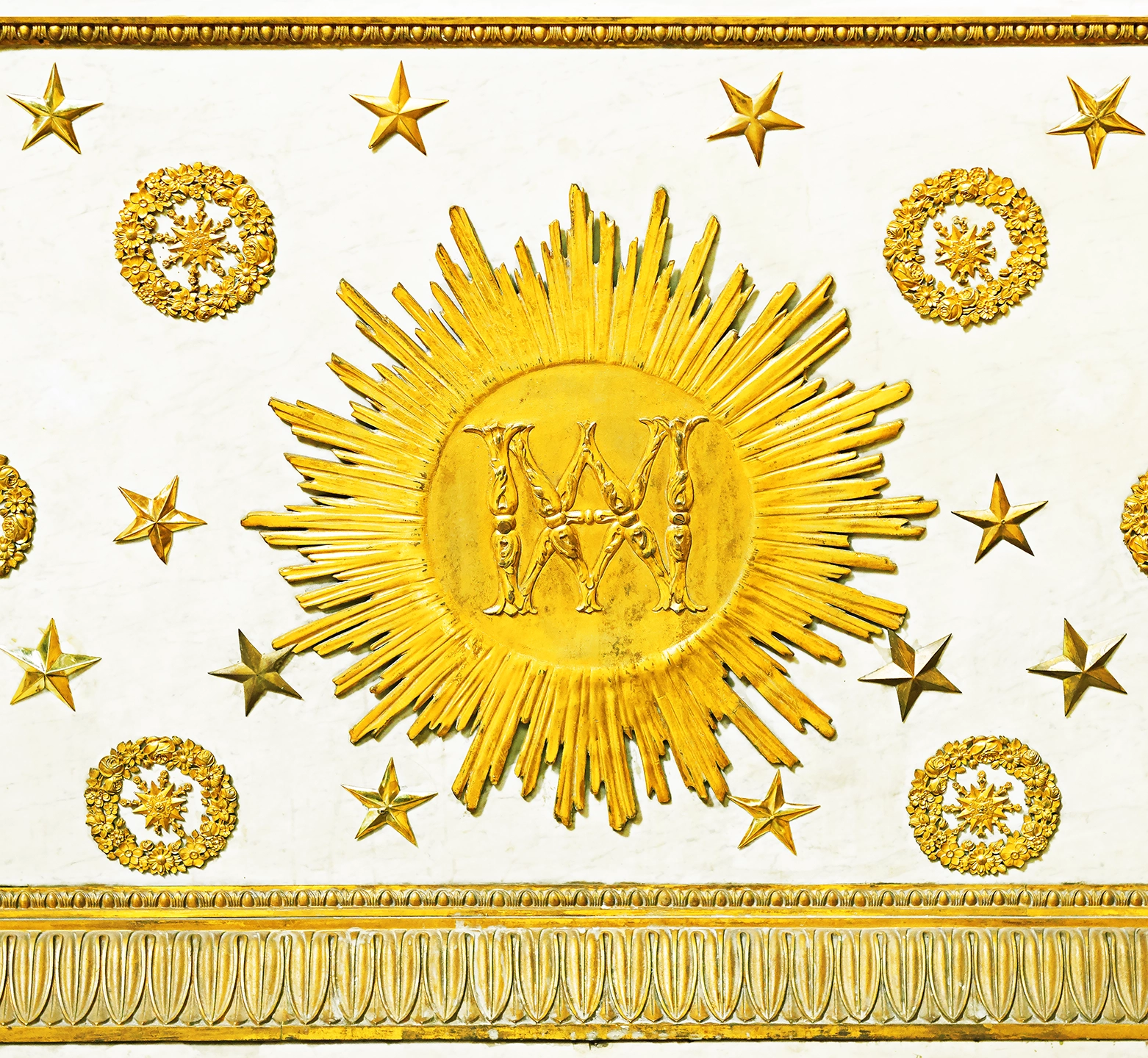
Au regard de la cosmologie universitaire, plusieurs
questions fondamentales sur la mécanique céleste restent encore sans réponse.
Voici, à mon avis, les plus pertinentes :
·
Qu’est-ce qui pousse la Terre à tourner sur
elle-même ?
·
Qu’est-ce qui pousse la Terre à tourner autour du
Soleil ?
·
Qu’est-ce qui pousse le système solaire à tourner
autour du centre de la galaxie ?
·
Pourquoi les planètes tournent-elles autour du
Soleil sur un plan commun ?
·
Pourquoi les planètes tournent-elles sur
elles-mêmes ?
·
Pourquoi peut-on prédire le mouvement et la
position des astres avec une si grande précision dans le temps ?
·
Pourquoi la Terre, le Soleil et toutes les planètes
ont-elles toute la forme d’une sphère ?
·
Suivant la loi de la physique action-réaction, quel
type d’énergie est consommé dans le mouvement des astres ?
·
Est-il possible que le mouvement circulaire de nos
astres brillants soit une réaction à l’action de cette mystérieuse énergie
noire ?
·
Les mystères qui entourent la mécanique de la
gravitation universelle ne seraient-ils pas les effets observables d’une cause
invisible au sein de l’énergie noire ?
Je pense que les réponses se
trouvent dans le cœur de cette abstraction du monde matériel qu’on appelle «
énergie noire ». Mais,
sachant que cet espace est invisible, inconnu et inexploré, comment
pouvons-nous franchir ses portes et l’appréhender ? Si la science moderne avait
atteint ses limites, vers où nous tourner ?
•••••
À l’âge de 30 ans (3), je mis la main sur un
livre intitulé Le mystère des Cathédrales et l’Interprétation Ésotérique
des Symboles Hermétiques du Grand Œuvre, écrit par Fulcanelli,
le célèbre adepte français. Cet ouvrage, classique et incontournable en matière
d’alchimie, fut l’étincelle qui mit le feu aux poudres de mes recherches, parce
qu’il donne des clés très précieuses pour déverrouiller les portes du royaume
métaphysique de l’énergie noire.
Cependant, l’accès à ces clés était dissimulé derrière l’écran
de fumée artistique d’un langage ‘‘imagé’’, cryptographique et cabalistique. Malgré
mon impuissance à fixer le parfum de ce langage, l’essence mystérieuse de cet
Art embauma mon esprit dès les premiers paragraphes écrits par le maître. Cette
vibration ne m’était pas étrangère, son arôme résonnait déjà de manière très
significative, naturellement, intuitivement, en mon for intérieur depuis ma
plus tendre enfance. J’étais alors loin d’imaginer que cet axiome linguistique
– la cabale – existait réellement en dehors de l’entendement de mon jardin
secret. Afin que vous compreniez de quoi il s’agit, voici une des meilleures
définitions de la cabale (du latin « cabbalus ») :
« c’est une langue d'espèce hiéroglyphique, jouant sur tous les
registres de l’expression : images, mots, lettres, nombres, sons, couleurs,
formes, poids, etc... Ainsi que sur des conventions secrètes, dont la métaphore
et les rébus emblématiques sont le type le plus répandu. Elle n'a pas de forme
propre ou particulière, et ne dépend que de la culture et de l'imagination de
ceux qui la mettent en œuvre. »
Aujourd’hui, malheureusement, la seule « kabbale » connue par l’atrophie de
la culture occidentale et de la
maçonnerie spéculative est apparue dans la tradition rabbinique au XIIIème
siècle en Espagne avec le Zohar – le livre des splendeurs. Contrairement au
consensus prosélyte, « kabbale » ou
« kabbalah », voire même « qabbalah » –
dans le but de servir une mystification plus efficace –,
n’est pas un courant original, isolé et prépondérant, mais le simple reflet
donné par la mystique juive à une tradition qui l’a précédée. D’ailleurs, le
mot « kabbale » n’est pas
d’origine hébraïque puisqu’il tire son étymologie du grec « kabbalès ». C’est pourquoi, afin
d’éviter le piège des homophonies, de promouvoir les inepties de la culture
populaire et d’affirmer l’universalité de son affiliation, les savants aiment
plutôt employer le terme de « cabale hermétique
» (en l’honneur du dieu grec Hermès).
Dans tous les cas, que ce soit « cabbalus
» en latin et « kabbalès » en grec, ces
termes définissent tous les deux l’animal emblématique de la connaissance
depuis la plus haute Antiquité : le cheval. De ce fait, la relation
sémantique entre « cabaliste » et « cavalier » devient on ne peut plus
évidente, cohérente et justifiée au regard des contes initiatiques, bien
souvent chevaleresques comme ceux écrits par Chrétien de Troyes depuis les
premières croisades et la découverte du folklore oriental. En effet, du haut
des sympathies astronomiques que nous partageons ici-bas, comment ne pas
contempler les chevaliers de la table ronde, le Roi Arthur et la quête du
Saint-Graal – le calice des calices – sous un angle différent de celui du prisme
hermétique ? Ce n’est pas un hasard (« hasard » est un terme d’origine
perse, il se traduit par « la main de Dieu ») si la journée du héros, toujours
incarnée par les aventures d’un preux cavalier (l’expression du Donum Dei), soit si emblématique pour une
tradition qui remonte à la nuit des temps : la monture de Pégase se
chevauchait déjà sous le dôme étoilé des castes sacerdotales chaldéo-égyptiennes.

Afin
de comprendre comment l’esprit de la cabale hermétique s’articule, prenons un
exemple littéraire avec le mot «
occulte » (ce choix n’est pas anodin, puisqu’il permettra
d’éloigner de votre pensée l’association que la culture vulgaire en fait avec
les pratiques démoniaques). La structure de ce mot se décompose en « o », « c » et « culte ». Pour
un hermétiste, le « o » est le
signe hiéroglyphique du Soleil et « c
», dans sa courbure, celui de la Lune ; en conséquence, « occulte » met l’accent sur le culte
voué à ces deux luminaires. D’un point
de vue opératif, cette lecture résonne avec la définition donnée par le
dictionnaire Larousse : « Qui agit, ou qui est fait de façon secrète, dont les buts restent
inconnus, cachés : une influence occulte ».
Avant
que l’universalité de la cabale hermétique ne soit fourvoyée par la
kabbale, et que l’École des Beaux-Arts ne feigne l’amnésie, tous les Artistes
(dignes de cette majuscule) s’en sont servis dans leurs œuvres pour parfaire le
beau sous ses meilleurs arcanes jusqu’à la fin du XIXème siècle.
Lorsque je pris pleinement conscience que ces esthètes se servaient de leur
création comme un canevas initiatique, mes pieds ne touchèrent plus le sol
pendant quelques jours. Cette épiphanie frisa l’illumination.
En
effet, la portée d’une telle pratique dans ma relation avec l’Art, aussi bien dans
l’interprétation du concept que dans l’exégèse de la culture en général, fut
une révélation sans précédent dans ma vie, car jamais je n’aurais pu imaginer
que ma prédisposition naturelle à trouver des analogies entre des choses qui, a
priori, n’en avaient aucune, se révélerait un jour être un de mes meilleurs
atouts dans ma quête de l’absolu. Ce que j’avais toujours pris pour une
malédiction – une pathologie psychologique – m’apparaissait désormais comme un
don qu’il fallait exploiter. Un signe venait de m’être envoyé, et je pris son
message avec la plus haute considération : l’hermétisme m’habitait.
Les
facéties qui entourent la destinée sont décidément plus que romantiques,
puisque cette tradition ancestrale avait la potentialité d’être une source
d’inspiration intarissable et de canaliser mes élucubrations les plus
métaphysiques. Je sus alors, sans l’ombre d’un doute, que les portes du
mystérieux royaume de l’invisible n’étaient plus à jamais scellées.
À
l’aube de mes 33 (6) ans, depuis le monde sublunaire, je me suis orienté vers
le Soleil levant.
•••••
Avant
de poursuivre, il me semble important d’ouvrir une brève parenthèse dans le but
d’expliquer pourquoi la philosophie hermétique et ses applications opératives –l’alchimie,
la magie et l’astrologie – ne sont plus respectées et valorisées comme elles le
furent par la science de nos anciens.
Assurément,
la simple évocation de l’une d’elles suffit à déclencher les ricanements de nos
contemporains. Cette mentalité, aussi méprisante soit-elle, fut chapeautée par
un courant de pensée né au XVIIIème siècle, qui osa détourner, sans
aucune pudeur, le sens et l’utilisation du mot « philosophie ». Soyons très clairs sur ce sujet, la philosophie
authentique n’a rien en commun avec la ‘‘philosophie’’ du Siècle des Lumières ;
les spéculations sociologiques, humanistes et naturalistes de celle-ci n’ont
jamais été les centres d’intérêt des philosophes de l’Antiquité tels que
Zarathoustra (environ VIème av. J.-C.),
Aristote (384-322 av. J.-C.) ou Confucius (551-479 av. J.-C.). Contrairement aux rédacteurs de l’Encyclopédie et
de leurs consorts germaniques, les vrais philosophes étaient animés par une
sincère quête de spiritualité, de sagesse et de vérité.
Du
reste, pourquoi ne pas avoir appelé leur courant intellectuel « la philosophie de la lumière » au lieu de « la philosophie des Lumières » ? Mettre le mot «
lumière » au pluriel marque une intention diabolique de fragmenter ce
qui ne peut pas l’être. Par cette manipulation, a priori anodine, la
vérité n’existe plus en tant que telle, mais devient faussement multiple et à
géométrie variable selon l’orientation de chacun. Alors, ne nous laissons
surtout pas aveugler par les tartuferies mondaines d’une certaine bourgeoisie
de salon en ne perdant pas de vue que l’authentique définition de la philosophie
est, dans son excellence étymologique, « l’amour de la sagesse ». Pythagore
(VIème siècle
av. J.-C.) précisait : « Je suis philosophe, non pas quelqu’un qui
prétend posséder la sagesse, mais un homme qui s’efforce vers elle. » Attribuer
aux mots une architecture revisitée, afin de détourner la puissance de leurs
égrégores et de détruire l’héritage traditionnel de notre passé, fait partie
des perversités qui ont été utilisées et financées par une “élite” dominatrice
pour asseoir la pérennité de leur pouvoir.
Sous
l’impulsion révolutionnaire du Siècle des Lumières, imputée à tort au peuple
par nos livres d’histoire, la société entra dans un obscurantisme effréné et
mortifère. Tout ce qui était rattaché aux croyances de la culture précédente
devait disparaître, s’effacer, s’oublier, et comme un symbole, nos majestueuses
cathédrales furent saccagées.

La
mentalité jacobine, parachevée par des initiations fallacieuses, où des
arrivistes en tout genre se sont engouffrés, porta définitivement le coup de
grâce avec l’idée abjecte que l’homme pouvait désormais être considéré comme
l’égal de Dieu. Ce genre de doctrine est un blasphème au regard chapitre 6,
verset 19, de la Première Épître aux Corinthiens (livre du Nouveau Testament),
écrite par l'apôtre Paul : « Ne
savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous,
que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ?
» Dès lors, l’enseignement gnostique de la transcendance divine n’avait
plus sa place dans le temple. Et l’opératif fut sournoisement remplacé par le
spéculatif : pourquoi s’évertuer à regarder le ciel et son planisphère
étoilé, puisqu’aux yeux de ces marchands, qui n’ont jamais vraiment quitté le
temple, il n’existe plus de vérité en dehors de celle de l’œil qui voit tout ?
Depuis
l’avènement de l’illuminisme : matérialiste, naturaliste et nominaliste,
tout ce qui ne peut être démontré, qualifié ou mesuré, n’existe plus. Comme
Saint Thomas, la science de l’encyclopédie ne croit désormais que ce qu’elle
voit, et les doctrines hermétiques furent définitivement rangées sur les
étagères de la superstition. Et n’ayons pas peur des maux, ce rationalisme
triomphant est à l’origine de l’immobilisme, du conformisme et du rationalisme
de la communauté scientifique d’aujourd’hui. René Guénon précisa : « Le rationalisme se définit essentiellement
par la croyance à la suprématie de la raison, proclamée comme véritable dogme,
impliquant la négation de l’intuition intellectuelle pure, ce qui entraîne
logiquement l’exclusion de toute connaissance métaphysique véritable. »
Parenthèse
fermée, revenons à une approche plus verticale de nos considérations.
•••••
Depuis
que les sociétés n’ont d’initiatiques que le qualificatif, le seul moyen de
trouver la grâce tant recherchée est de suivre, en toute indépendance, une voie
personnelle.
Pour
ce faire, il est essentiel d’étudier les mystères de la philosophie hermétique
par ses textes.
Pour
un occultiste, ce travail n’est pas une mince affaire, car cette littérature
regorge de faux-semblants. Si vous ne saviez pas que les initiés voilaient
toujours leurs écrits à l’aide de la cabale hermétique, afin d’éloigner les
envieux, leurs grimoires n’étaient d’aucune utilité. Beaucoup d’aspirants
furent ainsi mal inspirés. Michel Sendivogius, le
célèbre alchimiste du XVIIème siècle, plus connu sous le nom du
Cosmopolite, nous avertissait déjà : « Si Hermès, le père des Philosophes,
ressuscitait aujourd'hui, avec le subtil Géber, le
profond Raymond Lulle, ils ne seraient pas regardés comme des Philosophes par
nos chymistes vulgaires, qui ne daigneraient presque
pas les mettre au nombre de leurs Disciples, parce qu'ils ignoreraient la
manière de s'y prendre pour procéder à toutes ces distillations, ces
circulations, ces calcinations et toutes ces opérations innombrables que nos chymistes vulgaires ont inventées pour avoir mal entendu
les écrits allégoriques de ces Philosophes. »
À
cela, il faut ajouter qu’après le tsunami de l’illuminisme entre le XVIIIème
et le XIXème siècle, les faux prophètes se sont permis, afin de
subjuguer leur auditoire, “d’enrichir’’ l’héritage d’Hermès de textes tout
droit sortis de leur imagination. Sachant qu’il faut contourner ces
supercheries, l’essentiel de notre exégèse doit donc se concentrer sur les
textes de la tradition orientale, traduits en grec vraisemblablement depuis les
conquêtes d’Alexandre le Grand au IVème siècle avant l’ère chrétienne.
Lorsque
le Macédonien s’empara de l’Égypte et y installa l’un de ses généraux comme
nouveau pharaon (« pharaon » est un terme d’origine grecque qui se traduit par « celui qui porte le Soleil »),
l’horizon de cette terre ancestrale fut ravivé par la flamme lumineuse d’un
nouveau phare. La plupart du temps, l’annexion d’une terre sonne souvent le
glas de la culture locale, mais avec la lignée des pharaons ptolémaïques ce ne
fut pas le cas. Plutôt que de détruire pour imposer leur vision, les nouveaux
législateurs reconstruisirent le pays pour lui redonner sa splendeur d’antan.
Sous l’impulsion de la philosophie aristotélicienne, la culture
gréco-hellénistique se mêla aux enseignements multimillénaires des écoles de
mystères égyptiennes et du monde mésopotamien. Qu’il vienne de sages perses,
comme Zarathoustra (dont le nom signifie « l’étoile d’or » ou « la splendeur du Soleil »), ou de la
caste sacerdotale officiant dans les temples situés sur les rivages du Nil,
l’enseignement initiatique reçu par les Grecs n’est certes pas nouveau, car il
est souvent répété que Thalès de Milet (625-585 av. J.-C.), Pythagore (570-495 av. J.-C.) et Platon (428-347 av. J.-C.) en avaient déjà largement profité de leur temps. La
ville d’Alexandrie – rebaptisée du nom de son conquérant – devint alors un lieu
de rencontre et d’échange très prisé par tous les experts du bassin
méditerranéen en matière d’hermétisme et d’occultisme. Dans ce prodigieux et
merveilleux foyer d’érudits, de savants et de mages, la gnose (« gnōsis » se traduit du grec par « la
connaissance » et procède du désir de connaître Dieu et ses secrets) fut
incroyablement fructueuse. Malheureusement pour le salut de l’Humanité, la
plupart des manuscrits produits durant cette effervescence semblent avoir péri
dans les flammes de la mémorable bibliothèque. Cette ultime barbarie contre
l’héritage de nos pairs ne fut pas seulement le témoin d’un changement de
mentalité, elle marqua au fer rouge l’entrée de notre civilisation sous le joug
temporel de l’Empire romain pour les millénaires à venir.
Même
si, aujourd’hui, le pouvoir de Rome n’est plus aussi prépondérant dans sa
visibilité, soyez certain que son influence a su traverser les âges :
après avoir conquis les terres par l’épée, l’Église catholique – héritière
directe de l’Empire – s’est emparée des âmes par le crucifix.

Fort
heureusement pour la tradition, 17 manuscrits issus de la Philosophie
égyptienne à l’ère ptolémaïque refirent surface avec les traductions de Marsile
Ficin (1433-1499) – l’inévitable sommité de la Renaissance italienne.
Rassemblés sous l’appellation de Corpus Hermeticum,
ces textes sont considérés comme les textes fondateurs de l’hermétisme ;
sur la voie des sages, leur philosophie rayonnante agit comme un prisme naturel
et décompose la lumière de la révélation divine dans les thématiques suivantes
:
·
Ordre du cosmos
·
L’unité (omniscience, omnipotence et omniprésence
de l’éternel)
·
Le Soleil
·
Le démiurge
·
Cohésion des sphères
·
Fusion des contraires et la polarité
·
Le visible et l’invisible
·
La vérité et l’illusion de notre réalité
·
La création à travers la mise en mouvement
circulaire de l’unité
·
Le noos et
la volonté créatrice
·
Le temps, l’espace et la matière
·
Le corps, l’âme et l’esprit
·
Le bon, le beau, le bien et le juste
·
Les vices et les vertus
·
La création est un Art et la notion d’harmonie
·
L’Ogdoade
·
L’intelligence et sa relation à l’homme-dieu
·
Le rapport 12/10 (ou 6/5)
·
Le zodiaque et l’astrologie
À
l’évidence, l’évocation de l’astrologie dans cette liste peut paraître on ne
peut plus surprenante, mais sachez que, malgré le sort qui lui est aujourd’hui
réservé, les mages-initiés de l’Antiquité en ont toujours fait la pierre
angulaire de toutes leurs sciences. Avec la magie et l’alchimie, cet ésotérisme
rassemble, sous le vocable de la théurgie, les 3 voies opératives de la philosophie
hermétique. Elles forment un tout harmonieux et indissociable les unes des
autres. Il est alors peu probable qu’un alchimiste puisse se définir comme tel
sans avoir été initié aux magistères des deux autres disciplines.
L’importance
de cette trinité fut très bien comprise des Grecs, puisqu’elle est suggérée
dans le nom du dieu associé au père des philosophes, le bien nommé Hermès-Trismégiste. En effet, à côté de
la traduction communément admise de « trismégiste » par « le 3 fois très grand », on
peut tout à fait, grâce à la phonétique, soumettre à l’hypothèse un autre
niveau de lecture, soit « les 3 magistères ».
Même
si la doctrine trinitaire de l’unité a traversé le temps par le Panthéon du
monde grec, son origine historique est bel et bien égyptienne. La splendeur de
ce testament se retrouve sur le plateau de Gizeh, où les 3 pyramides rappellent à
l’intellect du contemplateur que la trinité divine est atemporelle, immortelle
et indestructible. Comment ne pas être subjugué devant la majesté, la grandeur
et le génie de la civilisation qui les a bâties ? Les propriétés géométriques,
astronomiques et énergétiques implicites à ces volumes révèlent aux yeux de
tous, mais surtout à ceux qui savent voir au-delà des apparences, la beauté
d’une pensée que la nôtre n’a jamais égalée.
Venu
de la nuit des temps, l’héritage de cette intelligence se personnifie également
dans les attributs du messager des dieux égyptiens, Djéhuty-Thot (la tradition s’est toujours plu à le comparer avec Hermès-Trismégiste). La plume du
regretté Jean Phaure (1928-2002) décrivait Djéhuty-Thot ainsi
: « il est le scribe de l'Ennéade divine,
le pinceau avec lequel écrit le dieu de l'univers, le créateur des langues, le
grand magicien des sphères qui préside à la création originelle pour appeler le
monde à l'existence par la parole, aux côtés de Ptah. Il est surtout celui qui
préside à l'ordre du monde, le grand calculateur, le maître des cycles du temps.
»
Il
est important de préciser que dans la théogonie des Égyptiens, Djéhuty-Thot n’était pas considéré comme un
dieu au sens propre du terme, mais plutôt comme un neter
(très proche phonétiquement de « nature ») ; soit la représentation
anthropomorphique d’une force,
d’une action de l’immanence divine dans le monde manifesté, une sorte
d’hypostase ou un æon,
comme aimaient le définir les gnostiques. On ne peut plus être aussi charitable
en vous offrant la clé qui ouvre l’accès aux 12 (3) versets de la Table d’Émeraude (Tabula Smaragdina en latin ou Lawḥ
al-zumurrudh en arabe), sur laquelle tout le
firmament de la philosophie hermétique est synthétisé. Tous les occultistes versés dans l’histoire des religions se sont
pris de passion pour ces écritures gravées sur une émeraude – une pierre
précieuse de couleur verte. Selon leur culture et leur époque, les plus lettrés
d’entre eux ont produit une kyrielle de traductions, plus ou moins
représentatives de la plus ancienne version répertoriée et écrite en arabe au
IXème siècle : l’appendice du Livre du secret de la création
(Kitâb sirr al-Halîka). Du point de vue de la tradition, l’affiliation
arabisante n’est pas dénuée de sens puisque les descendants des Perses
délogèrent les Byzantins d’Alexandrie au VIIème siècle, et
devinrent, par la force des choses, les vecteurs actifs de la transmission
initiatique.
Personnellement,
je préfère la traduction faite au XIVème siècle par Hortulain à partir de la Vulgate écrite en Latin :
I.
Tout ce qui est en bas, est ce qui est en haut : et
ce qui est en haut, est ce qui est en bas, pour faire les miracles d’une seule
chose.
II.
Et comme toutes choses ont été, & sont venues
d’un, par la médiation d’un : ainsi toutes les chose ont été nées de cette
chose unique, par adaptation.
III.
Le Soleil en est le père, la Lune est sa mère, le
vent la portée dans son ventre ; la terre est sa nourrice.
IV.
Le père de tout le Telesme
de tout le monde est ici. Sa Force ou puissance est entière,
V.
Si elle est convertie en Terre.
VI.
Tu sépareras la terre du Feu, le subtil de l’épais
doucement, avec grande industrie.
VII.
Il monte de la terre au ciel, & derechef il
descend en terre, & il reçoit la force des choses supérieures &
inférieures.
VIII.
Tu auras par ce moyen la gloire de tout le monde ;
& pour cela toute obscurité s’enfuira de toi.
IX.
C’est la force forte de toute force : car
elle vaincra toute chose subtile, & pénétrera toute chose solide.
X.
Ainsi le monde a été créé.
XI.
De ceci seront & sortiront d’admirables
adaptations, desquelles le moyen est ici.
XII.
C’est pourquoi j’ai été appelé Hermès-Trismégiste,
ayant les 3 parties de la Philosophie de tout le monde. Ce que j’ai dit de l’opération
du Soleil est accompli, & parachevé.
Ces
vers trouvent une curieuse résonance avec le prologue de l’Évangile de
Saint-Jean, cité ci-dessous :
I.
Au commencement était le Verbe (le Logos),
la parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu.
II.
Il était au commencement auprès de Dieu.
III.
Par lui, tout s’est fait, et rien de ce qui s’est
fait ne s’est fait sans lui.
IV.
En lui était la vie, et la vie était la Lumière des
hommes ;
V.
La Lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne
l’ont par arrêtée.
VI.
Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était
Jean.
VII.
Il était venu comme témoin, pour rendre témoignage
à la Lumière, afin que tous croient par lui.
VIII.
Cet homme n'était pas la Lumière, mais il était là
pour lui rendre témoignage.
IX.
Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme
en venant dans le monde.
X.
Il était dans le monde, lui par qui le monde
s'était fait, mais le monde ne l'a pas reconnu.
Effectivement,
les similitudes entre les deux textes sont plus que frappantes. Par conséquent,
les scribes de l’Église catholique se sont probablement inspirés de la sapience
contenue dans le souffle des textes hermétiques. Dans la création des ‘‘Saintes
Écritures’’, le plagiat de manuscrits antérieurs par les Pères de l´Église se
confirme à deux reprises. D´une part, L’Évangile de Jean ressemble à s’y
méprendre aux Évangiles gnostiques de Cérinthe datant du premier siècle de
l´ère chrétienne. D´autre part, l´Apocalypse (« apokalypsis
» se traduit du latin par « révélation »), écrite par Saint Jean, est
l’assemblage d’une kyrielle de textes sacrés, comme le Livre d’Hénoch
ou le Livre d’Ezéchiel.
Dans
un sens, la volonté d’incorporer des connaissances ancestrales au message de
l’apôtre favori du Christ (toujours accoutré d’un manteau vert dans
l’iconographie) indique que le catholicisme s’est façonné sur des doctrines
préexistantes. En plus, n'oublions pas qu’avant l’invention de l’imprimerie au
XVème siècle, falsifier un manuscrit était un jeu d’enfant ;
les assoiffés de suprématie religieuse, manièrent cette pratique avec le succès
que l’on connaît. Par exemple, en ce qui concerne les
écritures de l’Ancien Testament, tous les exégètes savent que les Dix
Commandements, supposément délivrés à Moïse par Dieu sur le mont Sinaï, ne sont
qu’un vulgaire plagiat du paragraphe 1:125 du Livre des Morts Égyptiens. Que cela vous plaise ou non,
la théologie hébraïque, mais également chrétienne, n’est qu’une pâle copie des
préceptes gnostiques du neter à l’unique œil
vert : Hor ou Horus – le porteur de lumière égyptien.
Rien de nouveau sous le Soleil, les égyptiens avaient également recyclé un
savoir antérieur. C’est pourquoi les différents textes
bibliques, le Pentateuque et les Évangiles canoniques ne pourront jamais être
considérés comme des vérités historiques ou des références théologiques
indiscutables.
Malgré
tout, même altérée, la littérature sacrée recèle encore bien des trésors
initiatiques sur lesquels il serait bon de se pencher, car le syncrétisme
théosophique, que l´on retrouve dans tous les textes d’une culture ou d’une
civilisation, suggère irrémédiablement une origine commune, une sorte de
tradition primordiale comme aimait à le définir René Guénon.
Ceci
dit, revenons aux vers de la Table d’Émeraude.
•••••
Dans ces vers, ce qui frappe de prime abord notre
attention est le principe totalement novateur qu’une force (« le verbe » dans
le prologue de Saint Jean) serait lié à la création du monde, à l’action du
Soleil (symbole de la lumière) et à la médiation de l’unité. Cette conception
ancestrale de l’origine de la matière est singulièrement très proche de la
déclaration que fit Max Planck, prix Nobel de physique en 1919 : « Toute
matière n’existe qu’en vertu d’une force qui fait vibrer les particules et
maintient ce minuscule système solaire de l’atome. Nous devons assumer derrière
cette force l’existence d’une conscience et d’un esprit intelligent. Cet esprit
est la matrice de toute matière. » En réalisant que les initiés de
l’Antiquité avaient déjà compris ce que les hommes du XXème siècle
commencent à peine de découvrir, on ne peut qu’être sidéré. Et ne nous
méprenons pas, c’est bel et bien l’existence de Dieu qui est suggérée par cette
sommité de la communauté scientifique.
La réalité de champs inaccessibles, indescriptibles
et incommensurables ne peut plus être regardée comme un artifice de films de
science-fiction ou comme les divagations des maîtres de sagesse venus d’Orient.
En faisant automatiquement référence aux films de Georges Lucas dès que l’idée
d’une force est mentionnée, la culture de notre génération ne se doute pas que
la description de la force faite par maître Yoda à son jeune apprenti et futur
chevalier Jedi, Luc, est en tout point
similaire à celle de la tradition des mages : « Mon allié est la Force
et c'est un allié puissant. La vie la crée, la fait croître, son énergie nous
entoure et nous lie. Nous sommes des êtres lumineux, pas de cette matière
brute. Tu dois sentir la Force autour de toi, entre toi, moi, l'arbre, le rocher,
partout. » Maîtriser la force, c´est accéder, comme vous l´avez deviné, au
rang de chevalier… Après de longs siècles d’ineptie religieuse, la science
adogmatique et la culture populaire peuvent enfin se réconcilier sur le terrain
fertile de la clairvoyance gnostique.
Avant de continuer, il est toujours bon de savoir
que les auteurs de Les Guerres de l’Étoile étaient des Artistes-érudits,
car « Luc » est issu
de la racine latine « lucere » et
du proto-indo-européen « leuk », qui signifie « lumière », « clarté » ou « énergie radiante » et « Jedi » est un emprunt phonétique à… Djéhuty-Thot.
Grâce à ces révélations sur la force, qui assimile
la création à la volonté d’une conscience intelligente ou d’un démiurge, les 12 (3) versets de la table d’émeraude guident la conscience de
chacun sur la primauté et l’exactitude de la vision des disciples d’Hermès. Là
où nos pairs se limitent à une science des effets : matérielle, nos ancêtres
surpassaient déjà le monde intelligible et se concentraient directement sur la
cause de la manifestation : spirituelle, en dehors du temps et de l’espace.
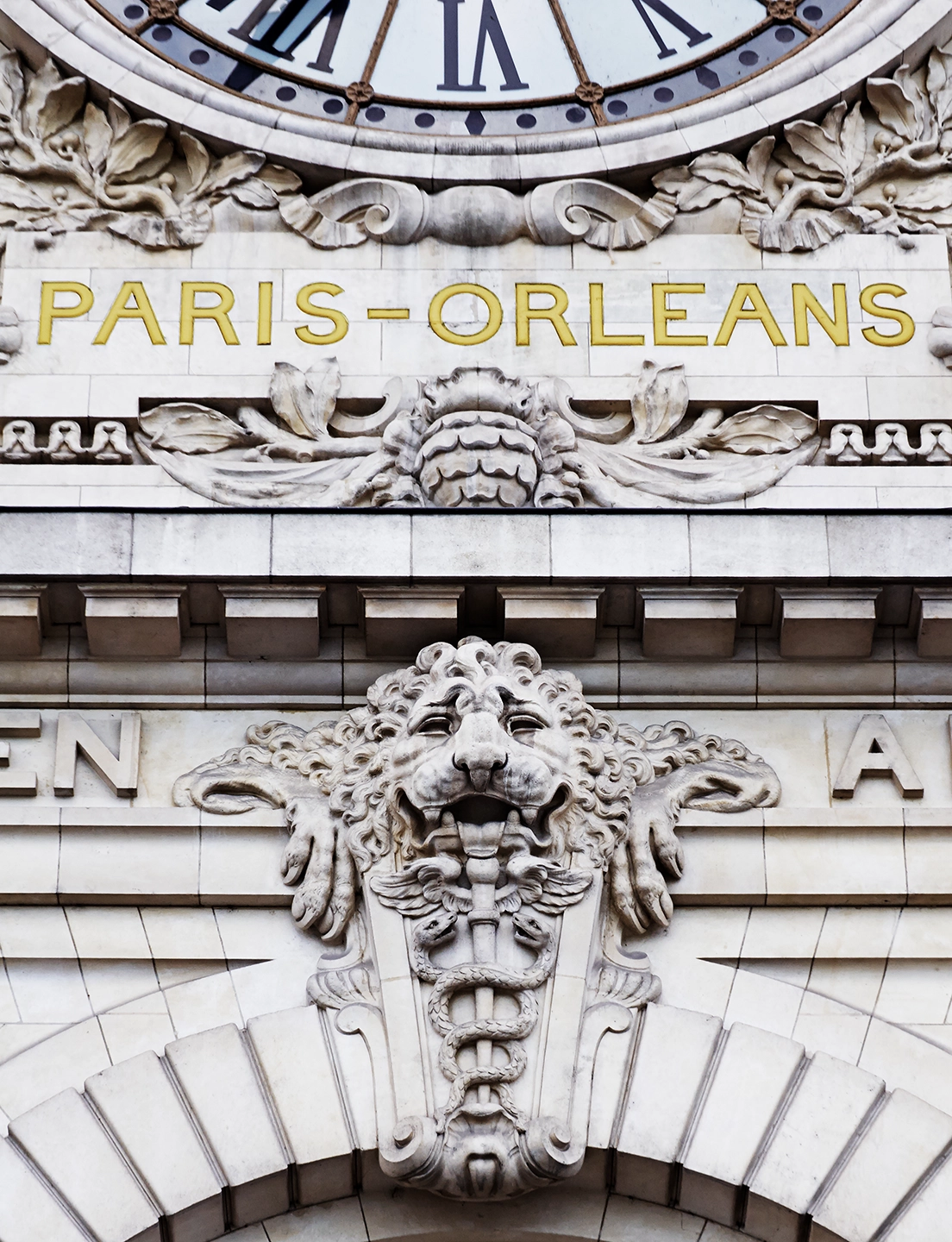

Les
adeptes de la philosophie hermétique ont toujours comparé les propriétés de la essence
spirituelle précédant la matière à celle d’un océan, car son eau remplit le
“vide” (« vidyā (विद्या)
» se traduit par « la connaissance » en sanskrit) comme dans n’importe quel
récipient. Cet océan fait écho à la mer cosmique d’énergie noire à laquelle
David Böhm faisait d’ailleurs allusion. Puisque l’homophone de « mer » : «
mère », vient de « mater » en latin, nous pouvons tisser des liens sémantiques
intéressants entre « mère », « mer », « mercure » (avatar d’Hermès-Trismégiste
chez les Latins), « matière », « matrice » et « Marie » (« Marie » est
l’anagramme d´« aimer »).
Si
cette matrice invisible est à l’origine de toute manifestation, l’assomption
qu’elle soit vierge coule de source et l´emblème de la Vierge noire (le noir, en opposition à la synthèse des 6 couleurs du spectre
visible, exprime l’absence de lumière), comme celui de la Vierge Marie, devient
alors plus explicite sous l’angle de la théosophie, puisque la Sainte-Vierge,
la reine mère, la mer divine, est la figuration ordinaire du mercure des
philosophes. Curieusement, l’anagramme d´« énergie noire » est « reine ignorée
», ce qui nous rappelle la parabole du verset 1:5 du Cantique des Cantiques,
probablement né des amours entre le Roi Salomon et la Reine de Saba : « Je suis noire, mais je suis belle (…) ».
Au
XIIème siècle, dans son ouvrage Livre secret traitant de l’art caché et de La Pierre Philosophale,
l’alchimiste Artéphius nous présentait l’eau des
sages de cette façon : « Ô combien est
précieuse et magnifique cette eau ! Car sans elle, l’œuvre ne pourrait être parfaite
: aussi est-elle nommée le vaisseau de la nature, le ventre, la matrice, le
réceptacle de la teinture, la terre et sa nourrice, elle est la fontaine dans
laquelle se lavent le Roy et la Reine, et la mère qu’il faut mettre et sceller
sur le ventre de son enfant qui est le Soleil. » Commencez-vous à comprendre comment les cabalistes brouillèrent
délibérément les pistes remontant à l’océan primordial par le maniement d’un champ lexical
volontairement alambiqué, afin de définir une chose unique, soit, en
l’occurrence, l’unicité de la matière – la materia
prima ?
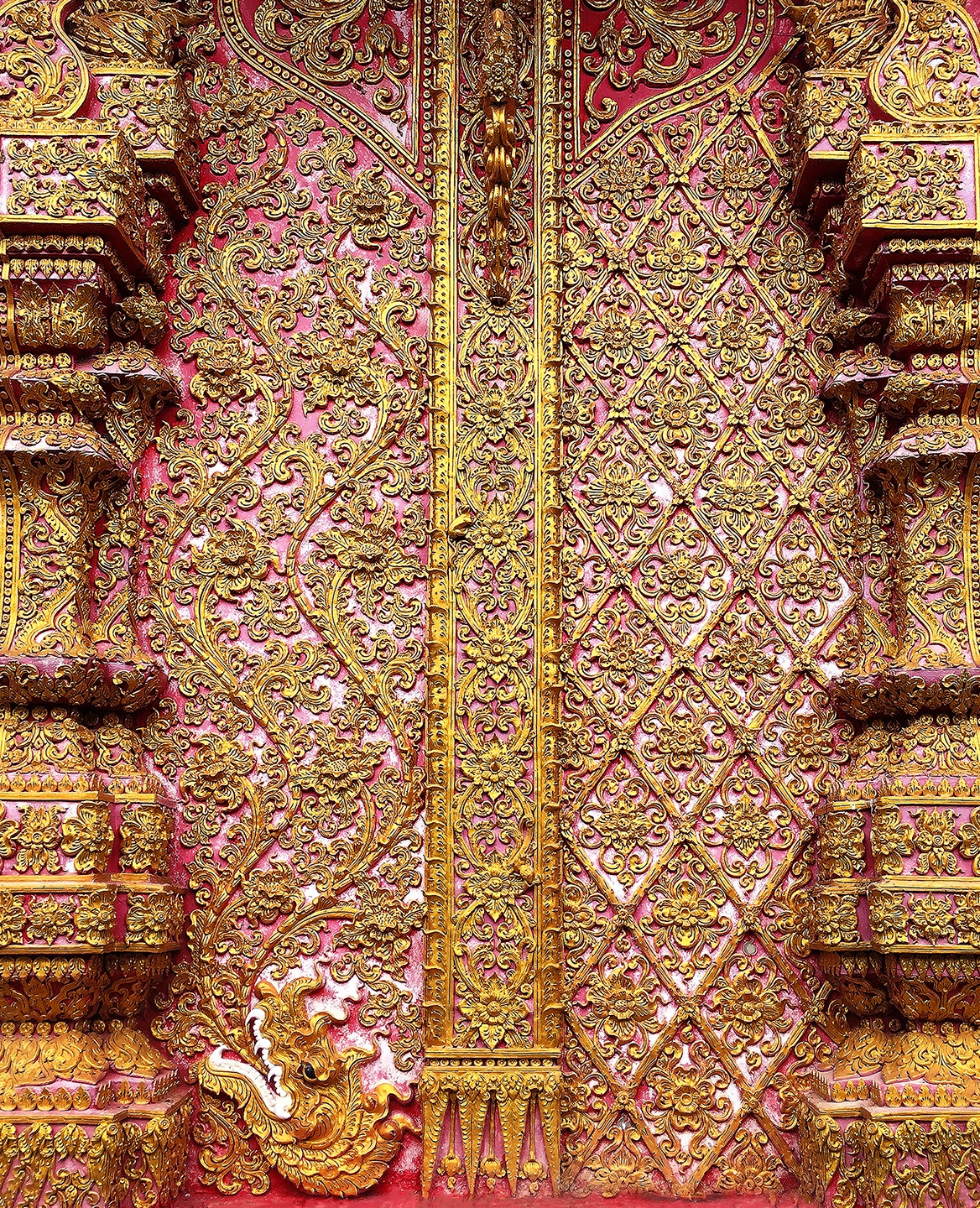
Dans
le Corpus Herméticum, le verset 16 de
l’extrait d’un discours entre Hermès et
Tat affirme que : « Tout ce qui existe est en mouvement ; le
non-être seul est immobile ». L’unité, état préliminaire à la manifestation
divine, pourrait alors être imaginée comme de l’énergie sous forme d’ondes
stationnaires, et lorsque cette énergie est vectorisée, le tout se met en
mouvement pour créer l’espace, le temps et, par conséquent, la matière. La
matrice universelle naîtrait de la rupture de l’équilibre spatial de
l’unité : cette première impulsion serait la force forte de toutes forces,
son Spiritus Mundi et son Saint-Esprit. Ce serait le passage de l’Ain Soph à l’Ain
Soph Aur dans
l’arbre de vie de la kabbale hébraïque.
Un
cabaliste chevronné décomposerait « saint » de « Saint-Esprit » en 3
parties, soit « s », « ain » et « t ». Le « t » muet est le tracé d’une croix, il
exprime le centre. « Ain » est le principe qui précède la matière, qui définit l’« abîme » et
« la non-existence » en hébreu et
s’entend « un », chiffre de l´unité en français, et « s » est la lettre de la
manifestation, parce qu’elle ondule comme la représentation graphique d’une
pulsation. En d’autres termes, le saint est une personne dont la signature
vibratoire résonne avec la première impulsion émanant du centre de l’unité.
C’est la raison pour laquelle l’âme d’un saint – son esprit – sera toujours au
plus près de la résonance divine et créatrice de l’Éternel.
Les
différents états de la matière pourraient alors se comparer aux barreaux d’une
échelle, où la force matricielle se cristallise, ou se condense graduellement,
dans des formes plus ou moins régulières. Cet état de fait est appuyé par la meilleure définition que vous pourrez trouver de l’alchimie, celle
de Fulcanelli : « L’alchimie est la
permutation de la forme par la lumière, le feu ou l’esprit. »

Même
si, d’après le témoignage d’Irénée Philalèthe (1628-1665), la transmutation métallique est une réalité, il est
important de souligner que faire de l’or pour s’enrichir n’a jamais été la
finalité de l’alchimie. Là encore, beaucoup se sont fourvoyés à ne pas
comprendre les écritures cabalistiques de nos aînés. Séparer le pur de l’impur,
c’est passer d’une matière vile à une matière rectifiée. Plus les arrangements
moléculaires deviennent simples et ordonnés, plus la matière et la source
matricielle tendent graduellement
vers la réunification, vers l’unité. La matière se purifie dans une révolution
inverse à la chute luciférienne (« Lucifer » est « le porteur de lumière » en latin,
et il apparaît pour la première fois dans la mythologie grecque, où il est le
gardien des chevaux du dieu solaire Apollon), d’où le concept nietzschéen
de l’éternel retour. La fameuse immortalité, sur laquelle les rêveurs
fantasment tant, n’est peut-être finalement que la recherche de l’éternité, de
l’immobilité absolue, là où l’éternel se repose, au plus près de l’unité.
Le
royaume de la science des adeptes est donc, par définition, en dehors du temps
et de l’espace. En outre, contrairement à la science moderne qui se préoccupe
exclusivement de la matière, l’alchimie, la magie et l’astrologie se polarisent
directement sur la matrice et les lois invisibles qui l’animent.
·
L’astrologie jauge les variations énergétiques du feu
céleste, en observant les influences des astres et des planètes sur le monde terrestre.
·
L’alchimie représente la manifestation de ce feu dans les organismes, a priori, inanimés
(les minéraux et les plantes).
·
La magie canalise directement ce feu dans le corps
de l’adepte. Celui-ci, en tant que mage dans le sens noble du terme, possède
une maîtrise parfaite du feu cosmique. Il parvient à faire transiter cette force
à travers les chakras de son corps, afin de la moduler et de la rediriger selon
l’usage qu’il souhaite en faire. Si l’amour divin remplit son cœur, il
pratiquera alors la magie
blanche, visant à créer harmonie et bien-être. À l'inverse, s’il
se laisse séduire par les ténèbres, il sombrera dans la magie noire,
utilisant cette force pour semer division et destruction.
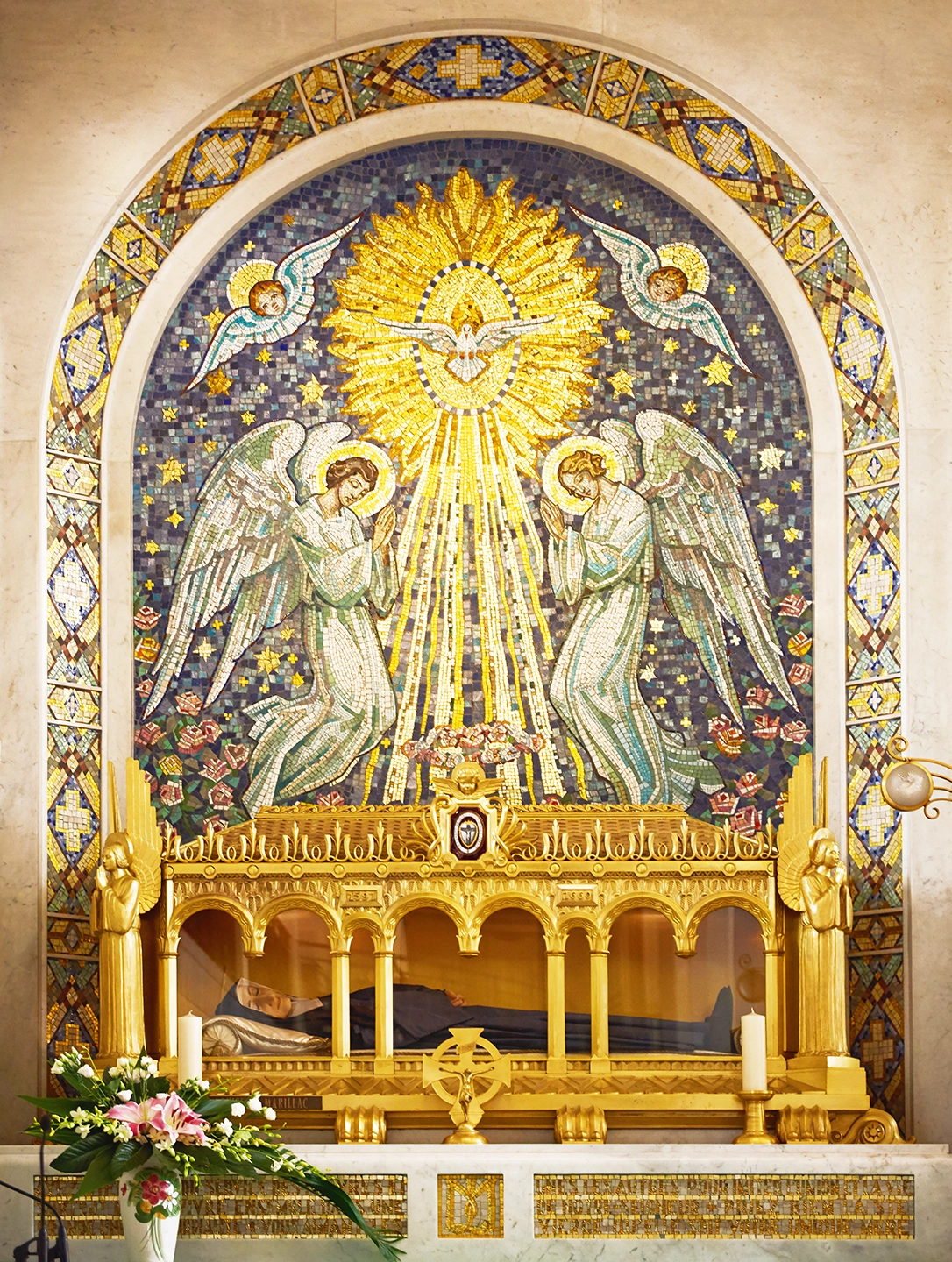
On
observe ainsi des arrangements spiralés de cette matrice numérique dans les
fleurs, le chou romanesco et la pomme de pin, mais aussi dans la
coquille des nautiles et des gastéropodes. Ces analogies sont tout à fait
stupéfiantes parce qu’elles ne se limitent pas à ces quelques exemples ;
elles trouvent un écho universel dans les
3 règnes du monde vivant : le
minéral, le végétal et l´animal. La nature fait de la géométrie,
automatiquement, sans équerre ni compas. La nature n’a pas besoin de plan, elle
est le plan. Son architecture, surtout lorsqu’elle s’exprime de manière hélicoïdale
(« hélicoïdale » et « hélice » ont la même racine étymologique qu’Hélios, le
dieu solaire des Grecs) et logarithmique, est tout simplement
éblouissante. Je ne comprendrai jamais pourquoi la plupart d’entre nous restent
encore stoïques devant tant de beauté et d’élégance. N’ont-ils pas d’yeux pour
voir ?
Depuis
le XXème siècle et les travaux de Matila Ghyka, le rapport de proportion égal à 1,618 est connu sous
le nom de « nombre d’or ». Employer cette appellation serait néanmoins une
grossière erreur, car une proportion n’est pas un nombre mais le rapport entre
deux nombres, dans leur expression arithmétique ou géométrique. Il est donc
préférable d’utiliser « proportion dorée » au lieu de « nombre d’or ».
L’étymologie
de « or » vient d´« aor », «
aour », « aur »
ou « our » dans
les langues sémitiques et se traduisent tous par « lumière ». Au souvenir du prologue de l´Évangile
de Saint Jean où il est écrit : « le
Verbe était Dieu (…) Le Verbe était la vraie lumière », la corrélation
entre Dieu, le verbe, la lumière et la proportion dorée devient plus
qu’évidente pour un des modes de pensée chez les mages : le raisonnement
synonymique. Si vous cherchiez une preuve concrète de l’existence de Dieu, la
proportion dorée donnerait à votre argumentation une dimension factuelle qu’il
serait difficile de réfuter. D’autant plus que le symbole grec la proportion dorée,
Φ, définissait chez les
premiers adorateurs du Christ « la force de Dieu », « la volonté » (« le Telesme » de la Table d’Émeraude) ou le principe de
concentration de l’esprit dans la matière.
La
signature de Φ se manifeste aussi dans
l’anatomie humaine. Parmi la multitude d’exemples que nous pourrions citer, le
cas du nombril est le plus significatif. En effet, sachant que le mot « nombril
» est l’homologue phonétique de « nombreel », les
cabalistes le décomposeraient en « nombre » et « el » pour en trouver la
substantifique moelle. Comme El est le nom de Dieu aux origines de
l’humanité, ce point, si spécial au regard de l’homme de Vitruve, est la
révélation physique de la signature divine dans les proportions du corps
humain. D’une part, c’est à partir de là que l’énergie nourricière de la mère
nous fut insufflée ; d’autre part, et c’est en cela qu’il nous intéresse
ici, il divise en moyenne la distance entre les pieds et la tête par la
proportion dorée. Le verset 1:27 de la Genèse qui
déclare que « l’homme a été bâti à
l’image de Dieu » n’est donc pas une parabole, il doit être compris de
manière littérale, au premier degré.
Le
dictionnaire Larousse nous explique que : « Φ est la 21ème
lettre de l'alphabet grec (21(3) = 3 x7), correspondant,
en grec ancien, à un « p » aspiré et, en grec moderne, à un « f ». Il est transposé
par « ph » dans les mots français issus du grec ». La
première syllabe des mots « philosophie », « physique », « phyllotaxie », «
firmament », « force » et « feu » souligne le rapport intime que ces mots
entretiennent avec la proportion dorée. L’étymologie est une science à manier
avec le plus grand sérieux, parce que, comme vous avez pu vous en rendre compte
précédemment, les clés d’investigation qu’offre cet outil sont inégalables.

On
observe ainsi des arrangements spiralés de cette matrice numérique dans les
fleurs, le chou romanesco et la pomme de pin, mais aussi dans la
coquille des nautiles et des gastéropodes. Ces analogies sont tout à fait
stupéfiantes parce qu’elles ne se limitent pas à ces quelques exemples ;
elles trouvent un écho universel dans les
3 règnes du monde vivant : le
minéral, le végétal et l´animal. La nature fait de la géométrie,
automatiquement, sans équerre ni compas. La nature n’a pas besoin de plan, elle
est le plan. Son architecture, surtout lorsqu’elle s’exprime de manière hélicoïdale
(« hélicoïdale » et « hélice » ont la même racine étymologique qu’Hélios, le
dieu solaire des Grecs) et logarithmique, est tout simplement
éblouissante. Je ne comprendrai jamais pourquoi la plupart d’entre nous restent
encore stoïques devant tant de beauté et d’élégance. N’ont-ils pas d’yeux pour
voir ?
Depuis
le XXème siècle et les travaux de Matila Ghyka, le rapport de proportion égal à 1,618 est connu sous
le nom de « nombre d’or ». Employer cette appellation serait néanmoins une
grossière erreur, car une proportion n’est pas un nombre mais le rapport entre
deux nombres, dans leur expression arithmétique ou géométrique. Il est donc
préférable d’utiliser « proportion dorée » au lieu de « nombre d’or ».
L’étymologie
de « or » vient d´« aor », «
aour », « aur »
ou « our » dans
les langues sémitiques et se traduisent tous par « lumière ». Au souvenir du prologue de l´Évangile
de Saint Jean où il est écrit : « Le
Verbe était Dieu (…) Le Verbe était la vraie lumière », la corrélation
entre Dieu, le verbe, la lumière et la proportion dorée devient plus
qu’évidente pour un des modes de pensée chez les mages : le raisonnement
synonymique. Si vous cherchiez une preuve concrète de l’existence de Dieu, la
proportion dorée donnerait à votre argumentation une dimension factuelle qu’il
serait difficile de réfuter. D’autant plus que le symbole grec la proportion dorée,
Φ, définissait chez les
premiers adorateurs du Christ « la force de Dieu », « la volonté » (« le Telesme » de la Table d’Émeraude) ou le principe de
concentration de l’esprit dans la matière.
La
signature de Φ se manifeste aussi dans
l’anatomie humaine. Parmi la multitude d’exemples que nous pourrions citer, le
cas du nombril est le plus significatif. En effet, sachant que le mot « nombril
» est l’homologue phonétique de « nombreel », les
cabalistes le décomposeraient en « nombre » et « el » pour en trouver la
substantifique moelle. Comme El est le nom de Dieu aux origines de
l’humanité, ce point, si spécial au regard de l’homme de Vitruve, est la
révélation physique de la signature divine dans les proportions du corps
humain. D’une part, c’est à partir de là que l’énergie nourricière de la mère
nous fut insufflée ; d’autre part, et c’est en cela qu’il nous intéresse
ici, il divise en moyenne la distance entre les pieds et la tête par la
proportion dorée. Le verset 1:27 de la Genèse qui
déclare que « l’homme a été bâti à
l’image de Dieu » n’est donc pas une parabole, il doit être compris de
manière littérale, au premier degré.
Le
dictionnaire Larousse nous explique que : « Φ est la 21ème
lettre de l'alphabet grec (21(3) = 3 x7), correspondant,
en grec ancien, à un « p » aspiré et, en grec moderne, à un « f ». Il est transposé
par « ph » dans les mots français issus du grec ». La
première syllabe des mots « philosophie », « physique », « phyllotaxie », «
firmament », « force » et « feu » souligne le rapport intime que ces mots
entretiennent avec la proportion dorée. L’étymologie est une science à manier
avec le plus grand sérieux, parce que, comme vous avez pu vous en rendre compte
précédemment, les clés d’investigation qu’offre cet outil sont inégalables.
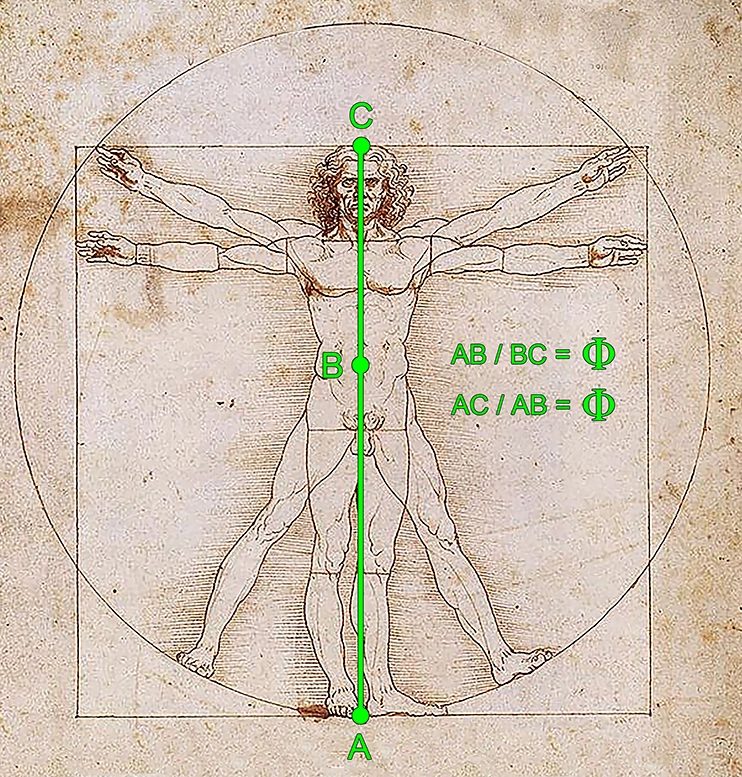
Devant
toutes ces sympathies, il me semble peu présomptueux d’affirmer que Φ, véritable pivot tourbillonnant de l’harmonie
universelle (à entendre « uni vers el »
ou « uni ver sel », soit « sel vert uni » pour une
lecture de droite à gauche), est l’empreinte organique d’une matrice créatrice,
dont la structure est assujettie aux lois de la géométrie et de l’arithmétique.
Platon l’avait très bien compris puisqu’il déclara : « Dieu fait toujours de la géométrie. » et « La géométrie attire l'âme vers la vérité, et forme l'esprit philosophique,
en forçant l'âme à porter en haut ses regards, au lieu de les abaisser. »
Pour
leur part, les historiens racontent que la proportion dorée fut baptisée « phi
» afin d´honorer le sculpteur Phidias (480-430 av. J.-C.), célèbre pour avoir participé à la construction du
Panthéon d’Athènes, où le rapport si précieux est exalté dans les proportions
de la façade. Devons-nous être estomaqués par le fait que la proportion dorée était
déjà utilisée cinq siècles avant l’ère chrétienne chez les architectes grecs,
mais également, d’après les travaux de René Adolphe Schwaller
de Lubicz (1887-1961),
chez leurs confrères égyptiens ? Absolument pas, car tous les Artistes,
dignes de cette majuscule, ont toujours essayé de faire résonner leurs œuvres
avec cette signature si particulière. Dans leur désir de singer la nature (à
entendre « saint G », où G est une présentation graphique de la spirale), ils
attribuèrent à Φ le canon ultime de la beauté. À chaque fois que Φ est utilisé, c’est un hommage syncrétique à la nature et
au créateur qui est célébré. Depuis les grandioses pyramides du plateau de
Gizeh jusqu’aux peintures abstraites de Kandinsky, Φ a toujours été l’apanage du génie Artistique et la
marque d’une relation symbiotique avec l’univers. Cette forme d’expression est
assurément née d’une nécessité, celle de révéler et de glorifier dans le monde
matériel l’intelligence invisible de la création divine.
•••••
N’en
déplaise à nos contemporains, l’Art d’avant le XXème siècle n’avait
rien en commun avec les ‘‘œuvres’’ d´aujourd´hui. Le mot « art » est devenu,
malgré lui, un terme fourre-tout dans lequel n’importe quelle création
plastique peut trouver sa place. Il suffit de fréquenter les galeries pour
prendre conscience que l’‘‘art’’ est devenu une mascarade intellectuelle et une
pollution visuelle sur laquelle des gens mal intentionnés ou des charlatans
essaient de faire leur fortune. En 1973, Jean Phaure
décrivait déjà ce courant avec l’objectivité qu’il méritait : « L'art moderne est une magie noire, parfois
au sens le plus opératif du terme, et a pour fonction eschatologique, comme la
psychanalyse, de replacer dans le champ de notre conscience notre
infra-psychisme peuplé de tous les résidus psychiques et démoniaques qui
avaient dans les phases précédentes du cycle été contenus dans ces caves par
l'art sacré, les religions et la connaissance initiatique. »
Nul
besoin de s’affranchir d’un doctorat en histoire de l’art pour s’apercevoir que
la créativité est, en comparaison avec les réalisations de notre passé, la
victime d’un processus de destruction commandité. En effet, comment peut-on
mettre sur le même piédestal les tableaux de Jackson Pollock (1912-1956) avec ceux de Michel-Ange (1475-1564), de Raphaël (1483-1520) ou
de Botticelli (1445-1410) ? Malheureusement pour le
genre humain, cette forme imposée de terrorisme intellectuel ne se limite pas
aux frontières de l’art, mais pourrit tous les piliers sur lesquels reposent
l’affranchissement d’une société saine et équilibrée.
À
cela, il faut ajouter que la créativité d’une personne ne fait pas
obligatoirement d’elle un Artiste. Les maîtres sont formels et sont toujours là
pour en témoigner : on ne devient pas Artiste du jour au lendemain,
perfectionner son Art demande beaucoup de travail et une ascèse spirituelle de
tous les instants. Sans être passé par la purification et la rectification de
son âme – faire preuve de sainteté – il est pratiquement impossible de recevoir
l’inspiration divine, de résonner avec la force et ne faire qu’un avec la grâce
de sa quintessence pour produire quoi que ce soit. Léonard de Vinci (1452-1519) enfonce le clou un peu plus profond dans la chair des
prétendants, bien souvent sans talent, en suggérant que la qualification
d´Artiste ne se mérite effectivement qu’en haut lieu : « L'artiste, sans cesse occupé à contempler la création, rend au
créateur un perpétuel hommage. Notre étude si patiente de l'œuvre divine,
demande plus d'efforts que de chanter matines. »
L’Art
induit donc une relation fusionnelle avec le sacré, et dans ce sens, il se doit
d’être un reflet de l’espace matriciel. Afin d’y parvenir, chaque détail doit
être mûrement réfléchi, mesuré et pesé. Absolument aucun élément ne peut être
le fruit du hasard. Et comme le soulignait Jean Phaure,
ce type de travail est aux antipodes de l’art spontané : les proportions
arithmétiques et les tracés géométriques régulateurs organisent une composition
harmonieuse et résonnante, le choix des couleurs s’accorde au symbolisme des
figures et des volumes, et les archétypes mythologiques et religieux se mêlent
aux références cabalistiques en tout genre. Et bien sûr, ne jamais oublier de
se souvenir du caractère hermétique de la forme, c’est-à-dire, comme le stipule
l’adage de la tradition : « montrer, signifier, et cacher… tout à la
fois ». La divinité ne montre pas… elle suggère !

Dans
le magma supérieur de l’esprit créatif, et puisqu’elle est souvent considérée
comme la pierre angulaire de tous les Arts, l’architecture occupe une place
privilégiée dans la relation qu’elle entretient avec les éléments naturels. La
synchronisation entre les propriétés d’un temple et les cycles temporels a
toujours été l’un des secrets les mieux gardés par les hautes sphères
initiatiques des castes sacerdotales. C’est dans la résolution de la quadrature
du cercle que la bâtisse est élevée vers le sacré, et fait ainsi valoir sa
fonction opérative en conjuguant les énergies célestes et terrestres en son
sein. Lorsqu’un temple est construit dans les règles de l’Art, sa forme
géométrique donne à l’espace son orientation, et comme une aiguille le ferait
sur un cadran solaire, elle donne aussi la mesure du temps. En cela, la
connaissance scientifique des cycles cosmiques élève l’Architecte au rang des
initiés, et, dans cette finalité, il ne peut pas en être autrement.
Malheureusement
pour l´Humanité, peu de personnes comprennent véritablement les systèmes de
codage employés dans les œuvres d’Art de nos ancêtres. Et même si leurs
tentatives sont couronnées de succès, la doxa universitaire les labellise
automatiquement comme de doux illuminés. Cette étiquette justifie d’autant plus
l’approche des Arts par le prisme de la psychologie chez les modernes, car il
faut bien tenter d’apporter une explication, même fantasmagorique, sur les
allégories, les métaphores et les paraboles de la culture traditionnelle de nos
maîtres. Quoi qu’il en soit, nous allons essayer de décrypter quelques œuvres
pour ce qu’elles furent réellement tout au long de cette thèse. Dans cette
optique, la meilleure manière de s’y atteler est d’utiliser les outils qui nous
ont été légués, et dans cette virtuosité, la mesure des Arts libéraux est
incontournable.
Les
Arts libéraux sont au nombre de 7 et se divisent en deux voies : le Trivium
et le Quadrivium.
·
Le Trivium se définit par l’expression du Verbe
(la Lumière) par les mots. Il se divise en 3 matières : la
grammaire, la dialectique et la rhétorique.
·
Le Quadrivium se rapporte aux pouvoirs des
nombres, soit l’expression du Verbe
par les mathématiques et se divise en 4 matières : l’arithmétique, la musique,
la géométrie et l’astronomie.
Aux
côtés de ces 7 voies, un axiome linguistique issu de la cabale hermétique,
appelé la langue des oiseaux,
vient compléter la palette déjà bien fournie de l’Artiste. Cet argot, qualifié
de solaire, dont les principes sont sanctifiés dans l’apparence de son
initiateur à la tête d’ibis, Djéhuty-Thot, se
base exclusivement sur l’assonance des mots, sans jamais prendre en compte les
règles de l’orthographe et de la grammaire. Richard Khaitzine
(1947-2013) en parlait de la sorte : « Cette langue des oiseaux, c’est celle révélée par Jésus aux apôtres
par l’intermédiaire de son esprit, l’Esprit-Saint. Souvenez-vous de cet épisode
tiré des Évangiles. C’est la période de la Pentecôte et les apôtres reçoivent
le don des langues sous forme de langues de feu, le feu étant un synonyme d’esprit.
Mais dans ce cas, vous demandez-vous, pourquoi l’appelle-t-on la langue des
oiseaux ? Parce que l’Esprit-Saint, de nature volatile, est fréquemment
symbolisé par un volatile, un oiseau, souvent une colombe. »
Dans
le but de combler les faiblesses du langage et de fournir les dernières clés
indispensables à l’ouverture du royaume fermé des mages, le disciple d’Hermès
utilisera un autre vecteur de transmission, encore très mal compris de nos
jours : le symbole.
•••••
Le
symbole joue un rôle plus que singulier : stimulant uniquement la psyché,
ce signe figuratif relie l’homme à son imagination et connecte sa pensée à des
sphères indescriptibles par les mots. En effet, le son d’un mot est une
vibration que l’ouïe peut entendre, et, dans cet état, il possède déjà une
manifestation matérielle. Le mot coupe donc maladroitement la dynamique de
l’idée qu’il souhaite définir ; c’est précisément pour remédier à cette
faiblesse que l’emploi du symbole démontre toute son efficacité. Par la
création d’un pont entre le créé et l’incréé, ce mode de lecture donne la
possibilité au mental de traverser le miroir des apparences, d’entrevoir
l’envers du décor, en dehors de l’espace et du temps. Ferdinand Brunetière (1849-1906) précisait : « Le
symbole est image, il est pensé… Il nous fait saisir entre le monde et nous
quelques-unes de ces affinités secrètes et de ces lois obscures qui peuvent
bien passer la portée de la science, mais qui n’en sont pas pour cela moins
certaines, tout symbole est en ce sens une espèce de révélation. »
Nous
ne pouvions pas continuer cette introduction sans honorer le verbe aiguisé de
René Guénon (1886-1951), parce que sa vie et
son œuvre cristallisent à elles seules une recherche spirituelle sans aucune concession.
Il écrivait dans son livre Symboles de la Science Sacrée : « Nous avons déjà eu I’occasion
de parler de l'importance de la forme symbolique dans la transmission des
enseignements doctrinaux d'ordre traditionnel (…) Pourquoi rencontre-t-on tant
d'hostilité plus ou moins avouée à l’égard du symbolisme ? Assurément, parce
qu'il y a là un mode d'expression qui est devenu entièrement étranger à la
mentalité moderne, et parce que l'homme est naturellement porté à se méfier de
ce qu'il ne comprend pas. Le symbolisme est le moyen le mieux adapté à l'enseignement
des vérités d'ordre supérieur, religieuses et métaphysiques, c’est-à-dire de
tout ce que repousse ou néglige l'esprit moderne ; il est tout le contraire de
ce qui convient au rationalisme, et tous ses adversaires se comportent,
certains sans le savoir, en véritables rationalistes (…) C'est ainsi que les
vérités les plus hautes, qui ne seraient aucunement communicables ou
transmissibles par tout autre moyen, le deviennent jusqu’à un certain point
lorsqu'elles sont, si l'on peut dire, incorporées dans des symboles qui les
dissimuleront sans doute pour beaucoup, mais qui les manifesteront dans tout
leur éclat aux yeux de ceux qui savent voir (…) Si le Verbe est pensé à
l'intérieur et parole à l'extérieur, si le monde est l'effet de la Parole divine
proférée à l'origine des temps, la nature entière peut être prise comme un
symbole de la réalité surnaturelle. Tout ce qui est, sous quelque mode que ce
soit, ayant son principe dans l'intellect divin, traduit ou représente ce
principe à sa manière et selon son ordre d'existence ; et, ainsi, d'un ordre à
l'autre, toutes choses s'enchaînent et se correspondent pour concourir à
l'harmonie universelle et totale, qui est comme un reflet de la trinité divine
elle-même. Cette correspondance est le véritable fondement du symbolisme et
c'est pourquoi les lois d'un domaine inférieur peuvent toujours être prises
pour symboliser les réalités d'un ordre supérieur, où elles ont leur raison
profonde, qui est à la fois leur principe et leur fin. »
Dans
sa figuration vulgaire, le saint bol prend la forme d’une coupe ou d’un calice,
lors du rituel magique de la messe, au moment du sacrement eucharistique, il
recueille le sang christique – liquide métaphorique du fluide cosmique.
L’évocation d’une essence aqueuse rappelle inévitablement la façon dont les hermétistes
associaient le comportement de l’esprit mercuriel à un océan primordial. En
suivant le raisonnement analogique, le symbole remplit exactement la même
fonction que son homophone, révélé par la langue des oiseaux, à savoir que le
saint bol est le réceptacle et le révélateur dans le monde tangible, des
principes indicibles de la matrice universelle.

Je
conçois que pour la plupart d’entre vous l’hermétisme paraît bien mystérieux,
voire même chimérique, d’autant plus que ce courant philosophique propose des
perspectives historiques et scientifiques que la pensée dominante qualifie
d’irrationnelles. J’entends déjà la rhétorique des plus endoctrinés : « Comment l’homme de l’Antiquité
pouvait-il connaître ce que la science moderne commence à peine à entrevoir
? Ne sommes-nous pas supérieurs à ces
bouseux du passé ? »
Eh
oui, et quoi qu’il en pense, l’homme d’aujourd’hui n’a pas conscience de son
ignorance. Mais, il ne faudrait surtout pas lui jeter la pierre, car, depuis
les bancs de l’école maternelle jusqu’aux amphithéâtres des universités, il est
poussé à répéter naïvement ce qu’on lui apprend. Et vu que la majorité a grandi
dans le même système, il est logique que les gens “normaux” soient tous
formatés de la même manière. À sa décharge, il faut reconnaître que la quête du
savoir, de l’enrichissement intellectuel et culturel est une activité qui n’est
plus valorisée. Absolument rien n’est organisé pour nous encourager à lire les
ouvrages des bibliothèques et à multiplier nos connaissances générales. Ce
triste constat est l’inexorable conséquence d’une éducation régalienne
constamment nivelée vers le bas, de la propagation et de la normalisation de la
culture de l’artificiel (au détriment du naturel), de la promotion et la
standardisation de la médiocrité par les médias dominants, de l’abrutissement
et de la manipulation hypnotique des masses par la télévision. Et surtout, du
déni toujours croissant d’un royaume spirituel transcendant et salvateur. C’est
un fait, on ne compte plus les amis qui sont très fiers de leur agnosticisme…
Quelle tristesse !
À
l’aube du XXIème siècle, l’effondrement de la pensée est à l’image
de la décadence, de la dégénérescence et de la déchéance de notre civilisation.
Cette sclérose intellectuelle est devenue un obstacle de plus en plus épineux à
franchir pour ceux qui prennent les chemins de l’évolution spirituelle, de
l’émancipation personnelle ou de la voie gnostique. Le conditionnement social
est tellement puissant que les intrépides, ceux qui osent encore réfléchir par
eux-mêmes, sont souvent mis sur le banc des infréquentables et sont
malheureusement sujets à la moquerie. Il faut faire preuve d’une sacrée force
de caractère pour se libérer de la vindicte populaire et du jugement d’autrui.
Ce travail demande une profonde et délicate introspection sur soi-même ;
très peu de personnes sont prêtes à souffrir pour dissoudre les illusions du
quotidien afin de s’en libérer complètement. Être capable de vider son calice
de toutes les scories, pour ensuite le remplir à nouveau d’une lumière plus
radieuse, est un accomplissement inaccessible pour la plupart d’entre nous.
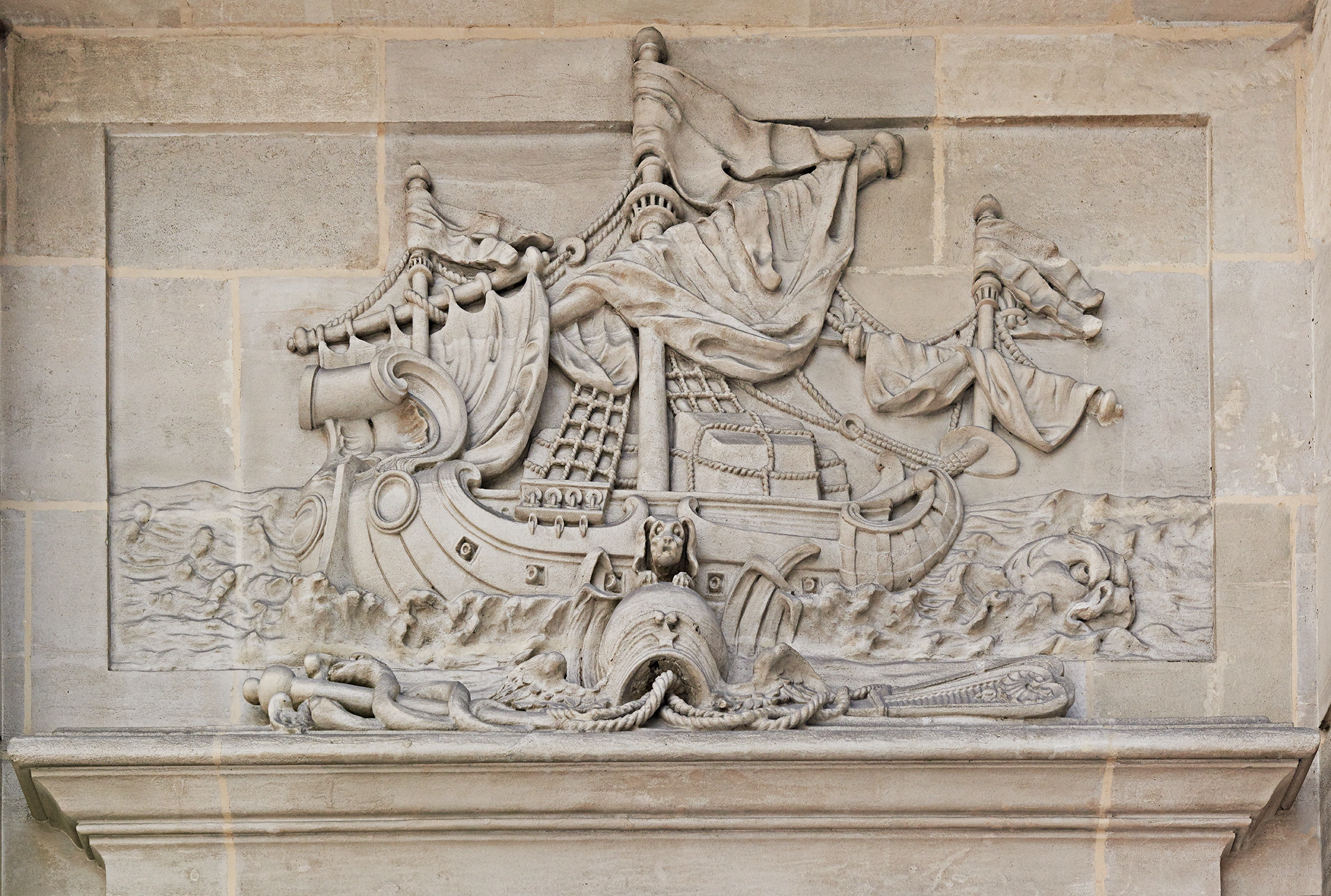
La
prudence, la tempérance, la force d’âme et la justice sont les vertus
cardinales nécessaires à l’ouverture du royaume de Dieu. Si la persévérance est
notre loyal serviteur sur le chemin de la vérité, l’essence verticale du feu solaire illuminera nos cœurs, et
le travail entrepris sera toujours couronné de succès. Sans cette quête
spirituelle, je n’aurais probablement jamais trouvé le courage de partager avec
vous ces quelques lignes, parce que les courants métaphysiques sur lesquels les
vents de cette démonstration vont nous porter sont ridiculisés par l’orthodoxie
du système éducatif et sont très mal compris par la culture globalisée
d’aujourd’hui. Cette thèse n’aurait jamais pu devenir une pierre originale ajoutée
à l’édifice, si nos préjugés habituels n’avaient pas été surmontés, si les
terres de l’inexploré n’avaient pas été repoussées et si notre réalité n’avait
pas été transcendée.
Pour
ce faire, l’étude scientifique et syncrétique des principaux symboles religieux
est l’axe majeur – son axis mundi – autour
duquel cette thèse évoluera. Tel un Jason moderne en quête de la Toison d’or,
guidé par la clarté de l’étoile polaire, nous naviguerons sur les océans
vibratoires les plus mystiques et les plus inimaginables. Je vous invite donc à
explorer la science sacrée à bord de mon vaisseau, à lever le voile sur la
nature naturante du Saint-Esprit et à larguer les amarres
vers le mystère le plus absolu de tous : la création de l’espace-temps.
Ludovic
Nicolas